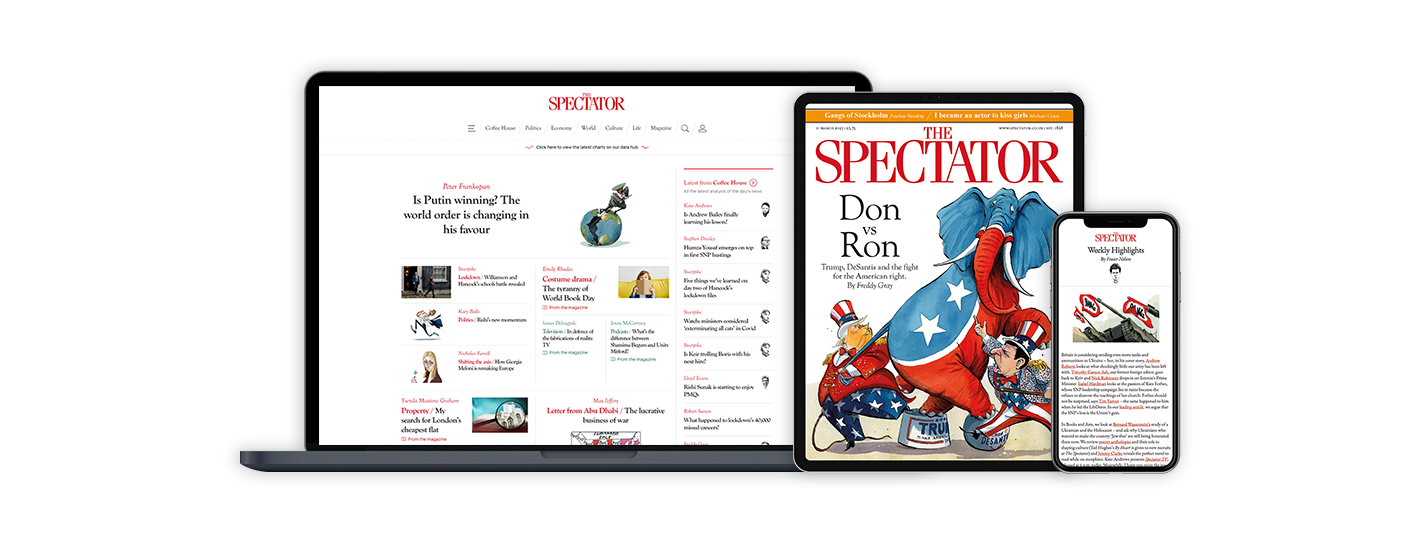Ils l’appellent « voyage de vengeance »: le désir de rattraper les opportunités de tournées que nous avons tous perdues lorsque nous étions enfermés dans nos maisons pandémiques. En tant que voyageur professionnel passionné, j’avoue que j’ai un cas redoutable de ce bug : j’ai passé les 20 derniers mois à aller à peu près partout où je peux, à rattraper mon retard.
Voici une brève liste des villes que j’ai visitées depuis mi-2021 : Tbilissi, Séville, Munich, La Nouvelle-Orléans, Lisbonne, Reykjavik, Bangkok, Erevan, Rome, Istanbul, Athènes, Da Nang, Nashville, Los Angeles, Florence, Phnom Penh , Tuson. Je pourrais en ajouter une douzaine de plus, mais vous comprenez l’essentiel. J’ai raté un nombre impressionnant d’engagements sociaux domestiques; mais j’ai récemment vu une grande partie du monde et, plus pertinemment, vu comment le monde urbain fait face à l’après-pandémie.
Le crime se cachait du mauvais côté des rails ; maintenant c’est juste là sur ton visage
Conclusion? Chaque ville a souffert de diverses manières et les cicatrices sont visibles. En Asie de l’Est, les lésions persistantes sont psychologiques : ils portent tous encore des masques. En Europe, la vie de rue normale et non masquée est revenue, mais les magasins, les gymnases et les restaurants fermés montrent que la douleur économique persiste. Certains quartiers d’affaires – comme la City de Londres, dans ma ville natale – mettent un temps inquiétant à retrouver cette vivacité aux heures de pointe. Ce ne sera peut-être jamais ce que c’était.
Cependant, il n’y a qu’un seul pays où je me suis réellement demandé : ces villes se remettront-elles un jour ? Pourraient-ils être en déclin terminal ? Et ce pays, ce sont les États-Unis, la patrie de la ville moderne telle que nous la connaissons, le berceau du gratte-ciel, de l’ascenseur et de l’idée de « centre-ville ».
Les villes américaines ont des problèmes complexes à l’échelle nationale, et chacune a son propre mélange tressé de difficultés post-pandémiques, mais je prendrai trois villes pour symptômer les principaux problèmes. Notamment parce que j’ai personnellement visité ces trois villes post-Covid.
Commençons par la Nouvelle-Orléans. Je visite depuis 20 ans, et j’adore la plupart, des bars à huîtres touristiques du quartier français à l’éclaboussure débonnaire de sherry servie dans votre soupe aux tortues dans le Garden District. J’aime les arbres majestueux dans les boulevards brûlés par le soleil, j’aime le balayage puissant du Mississippi indifférent, j’aime la façon dont vous pouvez voir les noms des rues et réaliser que Basin Street est en fait un lieu, pas seulement un célèbre morceau de jazz enregistré par Louis, né à Nawlins. Armstrong.
Mais lors de cette dernière visite, ce que j’ai remarqué avant tout, c’est le crime. Ou plutôt le sentiment du crime comme une menace omniprésente.
Le crime n’est pas nouveau pour NOLA. C’est une ville farouchement inégale avec une histoire troublée (le Big Easy a été la capitale mondiale de l’esclavage pendant plusieurs décennies, bien que les guides aient tendance à passer sous silence). Mais ce crime se cachait du mauvais côté des pistes ; maintenant, c’est juste là dans votre visage, alors que vous essayez de siroter votre Sazerac.
Les statistiques confirment cette ambiance. L’année dernière, la Nouvelle-Orléans a enregistré 280 meurtres, ce qui donne à la ville son taux de meurtres le plus élevé depuis 1996, ainsi que le taux de meurtres par habitant le plus élevé de tous les États-Unis. En effet, la Nouvelle-Orléans a maintenant le huitième taux de meurtres le plus élevé au monde (les sept premières sont toutes des villes mexicaines ravagées par les guerres de la drogue). Autrement dit, en termes d’homicides, la Nouvelle-Orléans est plus dangereuse que n’importe quelle ville d’Afrique.

Ce n’est pas non plus juste un meurtre. Les vols, les cambriolages, les viols, les vols à la tire, les agressions, la violence généralisée et les formes particulièrement brutales de vol de voiture connues sous le nom de détournement de voiture, où vous pourriez finir par perdre un membre ou votre vie si vous essayez de défendre votre Kia de location, sont tous en plein essor. Et cela se produit dans une ville embourbée dans une guerre culturelle empoisonnée, politisée, post-Covid et post-George Floyd, les concepts centraux de prison – et de caution – étant débattus avec colère et appliqués de manière incohérente.
Mon deuxième exemple de ville est Los Angeles. Ici, je ne peux avouer aucun amour personnel, bien que j’en aime certains aspects, des canyons dorés au Getty Museum. J’aime aussi le fait qu’il regorge de personnes exceptionnellement intéressantes et ambitieuses. Si vous voulez rencontrer une star du basket russe devenue scénariste nominée aux Oscars avec un grand intérêt pour l’informatique quantique, LA est votre place.
Malheureusement, à LA ces jours-ci, vous êtes beaucoup plus susceptible de rencontrer un ex-US Marine avec des plaies au visage criant des menaces folles aux pigeons alors qu’il sort de sa tente à moitié brûlée, à la recherche de fentanyl. Parce que LA – comme tant de villes de la côte ouest ensoleillée (et de plus en plus ailleurs aux États-Unis) – a un problème de sans-abrisme tout-puissant, résultant en partie mais pas entièrement de l’abus de drogues (loyers élevés, lois punitives sur les expulsions, absence de filets sociaux et facteurs d’attraction complexes sont également en jeu). Des statistiques récentes estiment qu’un habitant de la ville sur 200 est sans abri : environ 70 000 personnes.
Le problème des sans-abri de LA, comme le crime à la Nouvelle-Orléans, n’est pas une surprise totale – Skid Row au centre-ville de LA est historiquement connu pour une raison. Ce qui est nouveau, c’est la recrudescence des sans-abrisme et l’expansion géographique. Les sans-abri peuvent maintenant être trouvés n’importe où à Los Angeles : sous les autoroutes, dormant dans des voitures, dans des rangées de cabanes près des chemins de fer, ou simplement affalés sur un trottoir. On estime que cinq sans-abri meurent chaque jour dans la Cité des Anges.

L’ampleur du problème des sans-abri/de la drogue ici, et à travers les États-Unis, est telle qu’il a un impact désastreux sur l’espérance de vie aux États-Unis, qui est en chute libre étonnante. L’espérance de vie en Amérique est maintenant de 76,4 ans. À titre de comparaison, au Royaume-Uni, il est de 80,9 ans, au Canada de 81,7 et en Espagne de 82,3.
Pour mettre cela dans un autre contexte : l’espérance de vie à Cuba et en Thaïlande est supérieure à l’espérance de vie aux États-Unis, et si les tendances persistent, l’espérance de vie en Amérique sera bientôt dépassée par celle du Vietnam. Les médecins pensent que la drogue, la toxicomanie, les surdoses de drogue – toute cette horreur pharmacologique qui gâche la vie des pauvres dans leurs tentes moisies du comté de LA – est un facteur majeur. Les villes américaines pourraient ou non mourir, mais les gens meurent définitivement dans les villes américaines, trop souvent et trop tôt. Et cela dans un pays qui dépense plus en soins de santé que partout ailleurs.
Mon dernier exemple de ville est assez différent. Denver, Colorado. C’est en partie différent parce que ma visite l’automne dernier était ma toute première. Et mes premières impressions étaient bonnes. Denver brille. Il est clairement prospère (le Colorado est l’un des États les plus riches de l’Union.) À son meilleur, et à votre première approche, cela ressemble à une ville ordonnée, moderne, peut-être autrichienne, joliment agrandie, entourée de désert, de forêts et de montagnes. Il a même un quartier victorien bien préservé : ensoleillé et accessible à pied, plein de brasseries artisanales et de bars à whisky de l’époque Beat.
Cependant, après quelques heures passées à flâner dans cette jolie ville, un ami m’a murmuré : « Où est tout le monde ? La réponse n’y est venue aucune, car tout le monde n’est pas à Denver. C’est-à-dire que presque personne ne va plus dans le centre de Denver. Tout le monde travaille toujours à domicile, dans les interminables banlieues tictic-ticky qu’ils construisent continuellement sur les côtés gris des Rocheuses.
Certains habitants de Denver peuvent conduire en ville et au bureau, un ou deux jours par semaine. Ou ils viennent dîner. Certains ne le feront même pas. Je le sais, parce que je leur ai demandé. Ils déplorent l’état de la ville, mais ils aiment leurs grosses voitures et leurs grandes maisons, et le centre commercial local est si pratique et, vous savez, c’est tellement compliqué d’aller dans l’ancien endroit. Peut-être la semaine prochaine?
Dans certains quartiers de Denver, ce mélange bizarre de prospérité et de désolation semble presque hallucinant : les gratte-ciel scintillent dans le ciel bleu du Colorado, les nettoyeurs de rue ramassent les trottoirs immaculés, les cafés artisanaux branchés s’ouvrent tristement pour les affaires qui ne viennent pas.
C’est comme si une peste avait frappé l’endroit, ce qu’elle a effectivement fait – mais elle a frappé Denver bien pire que les villes ailleurs dans le monde, et les problèmes que Covid a engendrés ici pourraient ne faire que se multiplier. Parce que les rues vides encouragent le crime, et que le crime éloigne d’autant plus les gens, et qu’une population en baisse signifie une baisse des impôts, ce qui signifie alors moins d’argent pour faire face à des problèmes qui s’aggravent – et ainsi une ville entre dans une spirale de la mort de type Detroit.
Les villes américaines pourraient ou non mourir; les gens meurent définitivement dans les villes américaines
Si tout cela semble pessimiste, c’est parce que ça l’est. Ce n’est pas comme si j’avais sélectionné les villes les plus malchanceuses des États-Unis. J’aurais pu regarder Portland, Chicago, Philadelphie. J’aurais pu choisir San Francisco, dont les problèmes sont si graves que le New York Times en fait, il a renoncé à attaquer la «Grande-Bretagne dystopique» pendant une matinée et a plutôt mis la botte à Frisco, autrefois bien-aimé.
Mais j’aurais aussi pu regarder New York, qui possède au moins deux indicateurs troublants : sa population diminue (peut-être 300 000 ont quitté la ville pendant Covid, et ils ne reviennent apparemment pas), et les riches sortent également. Même la Big Apple a des asticots grignotant dans son noyau.
L’Amérique urbaine peut-elle renverser la vapeur ? C’est impossible à dire. De toutes les nations du monde, l’Amérique se spécialise dans le retour et le revivalisme. L’Amérique se voit souvent en Rocky Balboa : en formation sur les marches du Museum of Art de Philadelphie, prêt à renouer avec la gloire. Le problème est que si un Rocky Balboa des temps modernes s’entraînait sur les marches du Museum of Art de Philadelphie, il marcherait très probablement sur une seringue et mourrait d’un empoisonnement du sang.